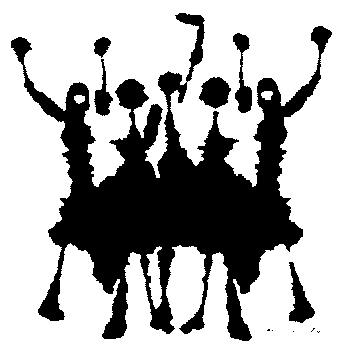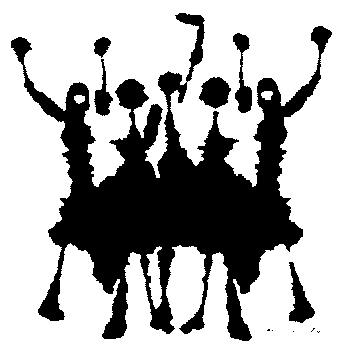 |
|
Claire
MESTRE * : Les détours de Frantz Fanon
Cherki A. A propos de Frantz Fanon Portrait
A l’occasion de la venue d’Alice Cherki à Bordeaux1, j’ai relu son récit sur Frantz Fanon,
psychiatre algérien d’origine antillaise dont la pensée est plus que jamais d’actualité. C’est un
livre passionnant, qui se lit d’une traite, surtout quand on a soi même lu Fanon. Il dessine un
Fanon attachant, brillant et surprenant, dans le regard de cette femme, psychiatre et
psychanalyste, qui l’a connu de près dans son exercice médical et politique.
Fanon était discret sur sa vie, et il ne s’agit pas là d’une biographie, mais plutôt de la
reconstruction d’une pensée, celle de la violence, inscrite dans un contexte, pour « sortir de
l’idéalisation forcenée, de la mise en place d’un héros coupé de l’Histoire, ou à l’inverse rompre
un silence impuissant devant le dénigrement effarouché d’un Fanon apologiste de la violence
ou lié à un tiers-mondisme obsolète » (p. 11).
Alice Cherki sauve de l’oubli des facettes ignorées ou mal connues de Fanon, en particulier son
œuvre psychiatrique face aux grandes questions de l’altérité, et sur laquelle j’ai été
enthousiaste. Je m’attarderai plus sur ces aspects. L’auteur retrace ainsi son engagement
très jeune dans la résistance française contre le nazisme, ses études de psychiatrie à Lyon,
son apprentissage de la psychothérapie institutionnelle, puis son départ en Algérie d’où il sera
expulsé à cause de ses prises de position politiques, et enfin son engagement politique auprès
du FLN à la fin de sa vie en Tunisie.
La prise de conscience dans sa Martinique natale d’un déni de l’histoire sera précoce et
enclenchera probablement l’élan vital qui le propulsera dans une bataille forcenée contre le
mépris et le racisme de l’autre, le dominateur. Ses premiers contacts avec la Métropole sont
violents : il la rencontre dans la guerre, mais surtout dans le mépris et la discrimination que
les combattants antillais et des colonies suscitent. Il en gardera pour sa vie entière « une
culture de résistance ». Plus connu est son parcours d’étudiant à l’université de médecine de
Lyon. Il y découvre également la philosophie et se lance dans l’écriture, avec notamment une
première publication dans Esprit sur le « Syndrome nord africain »2, comme symptôme du
racisme médical. Peau noire, Masques blancs aurait dû être son écrit de thèse… et sera publié
en 1953 au Seuil. Ce livre décapant, très en avance sur les autres écrits sur le racisme,
illustre la pensée naissante de Fanon qui témoigne des dégâts du discours dominant en
l’occurrence colonial sur la personne et son inconscient. Fanon se fait le penseur de l’aliénation
et surtout propose comme seule issue possible l’action sur le réel. Le matériel utilisé est
multiple issue de sa propre expérience de « nègre » en France, de la clinique, de la littérature
et aussi de sa confrontation avec Mannoni. Des grandes questions émergent qui restent pour
nous cliniciens totalement d’actualité : l’aliénation à la langue dominante, le passage à
l’universel par le particulier, la nécessité de l’engagement du corps et de la pensée face à
l’aliénation, y compris dans l’institution asilaire.
Pour l’heure, Fanon met en exercice la psychothérapie institutionnelle à St-Alban en Lozère
avec son unique maître, le Dr Tosquelles, psychiatre et émigré espagnol antifranquiste. Fanon
résiste à la psychanalyse même si elle est une référence fondamentale : il est avant tout
préoccupé par l’articulation entre psychisme et histoire, psychisme et réalité sociale,
discriminante surtout.
Fanon arrive à Blida (non loin d’Alger) où il est nommé chef de service et où il restera trois
ans (1953-1956). Il découvre une société dont la réalité est très lointaine d’une Algérie qu’on
voudrait française, c'est-à-dire porteuse des valeurs de la République : le racisme colonial y
est omniprésent, paternaliste et ségrégationniste. Fanon découvre également une société
plurielle où se côtoient malgré tout, Juifs d’Algérie, Européens, et Arabes musulmans. Fanon a
des contacts décevants avec les intellectuels , cependant que dans sa pratique psychiatrique il
est armé pour mettre en lumière psychopathologie et « écrasement culturel » et le
transmettre à ses élèves (dont fait partie Jacques Azoulay).
Fanon organise une véritable révolution des soins psychiatriques dans un hôpital public (2000
pensionnaires, il a la charge d’un quart) marqué par la pauvreté des moyens, l’abandon des
malades, qui ressemblent plus à des détenus et la résignation des médecins : organisation de
fêtes, d’activités culturelles, des ateliers d’artisanat où personnel infirmier et malades
collaborent. Cette organisation sera une véritable réussite auprès des femmes européennes…mais sans intérêt pour les hommes musulmans. La création d’un « café maure », la mise en
valeur des fêtes religieuses et de la culture algérienne à travers la musique et les contes,
permettront aux aliénés de s’y identifier. Fanon organise également des réunions
institutionnelles où sont travaillés l’accueil et l’histoire de chacun. Il sort aussi des murs de
l’asile pour apprendre à connaître avec ses internes les pratiques culturelles et
thérapeutiques du pays.
Il ne faut pas oublier que l’action de Fanon se déploie alors que la pensée psychiatrique
dominante est celle de d’Ecole d’Alger dont la figure éminente est celle de Porot, héraut du
primitivisme, pensée raciste qui réduit les Nord-Africains à des êtres porteurs d’un
psychisme primitif, illogique, et d’une personnalité paresseuse, menteuse et
potentiellement criminelle. Cette thèse peut se résumer à celle de Carothers qui fait de « l’Africain normal un
Européen lobotomisé ». La création de lieux de loisirs pour les malades, l’enseignement aux
infirmiers et l’ouverture d’un service ouvert sont dans ce contexte tout à fait
révolutionnaires.
Fanon continue à réfléchir dans ce bouleversement institutionnel qui accompagne l’avancée de
sa pensée : ni toute noire, ni toute blanche, mais en mouvement. Il est connu pour ses
positions anti-colonialistes et c’est ainsi qu’il est contacté par le FLN en 1955. C’est sa
compétence de médecin psychiatre qui est sollicitée pour soigner les troubles mentaux des
maquisards. L’équipe de Fanon mène ainsi de front une intense activité de soins
psychiatriques, de recherches innovantes (par ex nouveau TAT, recherche sur les djouns dans
la psychopathologie…) et de militantisme anticolonialiste. En 1956, dans un contexte de luttes
anticoloniales et l’explosion d’un conflit armé, Fanon tout en intensifiant ses liens avec la
résistance, continue d’écrire : il prononce « Racisme et culture » au Premier Congrès des
Ecrivains et Artistes noirs à Paris. Il y défend l’idée que la forme du racisme est
contemporaine d’un contexte, et que le racisme moderne s’attaque par l’oppression et la
spoliation à ce qui rend vivante une culture, en gros, il la momifie, la cadavérise. La
colonisation empêche le dialogue des cultures et leur enrichissement mutuel. En Algérie, les
affrontements se durcissent, l’hôpital de Blida est considéré comme « une véritable nid de
fellaghas » et Fanon démissionne. La réponse à sa lettre ne tarde pas à arriver : il est
expulsé.
Il s’éloigne progressivement des intellectuels français, frappé par l’atmosphère de silence qui
règne en France ; sa décision est prise il part pour Tunis en 1957, acheminé par la branche
française du FLN.
Là, il est engagé dans le service de presse du FLN, tout en continuant ses activités
psychiatriques, d’écriture et d’enseignement. Fanon, officiellement membre du FLN, écrit
dans une langue particulière qui va « du corps aux mots », « de la tension des muscles à la
prise de conscience », et il rencontre nombre d’intellectuels, journalistes, philosophes,
politiciens, hommes de culture… C’est un militant dévoué, journaliste anonyme de El
Moudjahid, loin des intrigues politiques et qui encaisse aussi les mensonges de son
organisation. Il est surtout porteur d’un projet de société qui va au-delà de l’indépendance, au
contraire de nombre des autres résistants : il rêve d’une révolution qui modifierait les
rapports humains entre les communautés, d’une société laïque. Il prend position sur la torture
comme un acte profondément inscrit dans la position coloniale et constate l’impossible
identification du peuple français au peuple algérien.
Du côté psychiatrique, son arrivée produit des remous dans une communauté médicale
marquée par le cosmopolitisme. Il continue à soigner des réfugiés algériens, militaires ou
maquisards, mais surtout il s’engage dans un nouveau projet expérimental : l’hospitalisation de
jour (accompagné de ses collègues Cherki et Géromini). Cette idée très novatrice met en
scène des expériences multiples : psychothérapies, traitement biologiques, et activités
collectives : psychothérapies de groupe et soins par le travail. Mais surtout, Fanon se fait
psychanalyste, possédant des références sûres et malgré tout se trouvant mal préparé au
transfert de ces patients : sa pratique le renforce dans son affirmation que l’inconscient est
construit à partir d’une culture et d’une histoire singulière.
Fanon rêve d’Afrique et d’articuler la révolution algérienne aux mouvements de libération
africains. C’est une facette de plus pour cet homme bouillonnant qui semble vouloir diversifier
ses expériences avec au centre de lui-même une vérité : se séparer de son origine sans la
renier et surtout s’appuyer sur sa propre singularité en mouvement pour influencer le destin
collectif. Il écrit L’an V de la révolution algérienne, livre qui s’adresse aux Français comme aux
Algériens et dont le matériel est toujours multiple : clinique, échanges intellectuels, lectures,
expérience personnelle. Il y poursuit sa dénonciation de la colonisation, en appelle à une
décolonisation totale, et pour le colonisé, et pour le colon.
Fanon est nommé ambassadeur itinérant de l’Algérie en guerre. Il rencontre les Présidents
des Etats nouvellement indépendants (Ghana) mais aussi les leaders des mouvements de
libération (Congo, Côte d’Ivoire, Guinée…). Certains deviendront des amis. Il rêve d’unité
panafricaine. Il se méfie des concepts anthropologiques de l’ethnicité et de la culture qu’il
pense avant tout comme « acte politique » et non comme une forme fixe. Dans cette
tourmente africaine, Fanon l’utopiste s’éloigne de plus en plus des préoccupations françaises.
La maladie va arrêter cette trajectoire fulgurante. Fanon aurait préféré mourir dans le
maquis. Mais il va lutter autrement, accepte d’être soigné à l’étranger (en Russie puis aux
USA) et écrit son dernier ouvrage Les damnés de la terre. Il croise le couple De Beauvoir et
Sartre, qui aura à écrire la préface de son livre. Il paraît et Fanon meurt fin 1961 à New
York, il sera enterré en terre algérienne selon ses vœux.
Le message de Les damnés de la terre sera entendu de façon contradictoire : l’appel à la
décolonisation, le recours à la violence pour y arriver, (aussi puissante que celle qui a imposé la
colonisation), la mise en garde contre les échecs de ce projet, sont scandés par une écriture
corporelle, un rythme vif qui écorchent les yeux des intellectuels français. Cette violence
nécessaire au désassujettissement, libératrice pour tous, surtout pour les plus déshérités
devrait avoir pour relais les partis nationalistes et met à contribution intellectuels et
artistes. Pour ma part, je retiendrai les très impressionnantes histoires cliniques,
impressionnantes du fait de l’acuité de celui qui les recueillies, impressionnantes par les
impacts effroyables sur la psyché de ceux qui en sont les acteurs. Je proposerais volontiers
de les lire à la lumière d’une modification violente de la relation à l’autre, l’autre l’ennemi, le
colon.
Que reste-t-il aujourd’hui de Fanon ?
Des structures psychiatriques qu’il a inaugurées, plus grand-chose d’après Alice Cherki.
Sa pensée politique, minimisée par certains, magnifiée voire idéalisée par d’autre aura un
avenir surtout aux USA. On retiendra de lui comme plus bel éloge, « un éveilleur des
consciences plutôt qu’un théoricien politique ».
Quelle place peut avoir la pensée fanonienne face à la population issue de l’émigration ? et je
pense au texte d’Esprit qui ne serait pas renié par Abdelmek Sayad de « La maladie, la
souffrance et le corps », dans La double absence des illusions de l’émigré aux souffrances de
l’immigré.
Quelle place pour l’œuvre psychiatrique de Fanon dans la réflexion sur nos lieux de soin qui
doivent accueillir et valoriser l’altérité culturelle, la culture étant pensée comme un recours
possible, un moyen d’anticiper et d’agir (et non bien sûr comme une forme fixe indépendante
du sujet) ?
Quelle place pour la pensée fanonienne dans les questions de l’origine ? Le plus beau
commentaire vient de Glissant qui parle de « détour » : « Le détour est le recours ultime d’une
population dont la domination par un autre est occultée. Il faut aller chercher ailleurs le
principe de domination, qui n’est pas évident dans le pays même ». Par association d’idée, je me
prends à penser que le détour par l’autre ouvre à sa propre altérité, détour essentiel à mon
avis dans le soin ethnopsychiatrique. Fanon par son parcours m’évoque la position de celui qui
est toujours en décalage, noir en France, Français en Algérie, Algérien en France et pour
l’Afrique, comme pour toujours mieux reconnaître l’altérité, surtout si elle risque de
disparaître derrière la domination. C’est évidemment un message universel que d’interroger
sans cesse l’entre-deux pour l’assumer : je ne renie pas l’origine (encore faut-il que je la
connaisse), mais je suis ailleurs.
Enfin, Alice Cherki souligne combien la honte décrite par Fanon est un affect fondamental à
repérer dans une clinique du quotidien mais aussi dans celle de la rupture de la continuité
subjective, qu’elle soit issue des catastrophes humaines (génocides, tortures,etc.) ou de le
regard pétrifiant d’un autre.
Les écrits de Fanon ne lui appartiennent plus. Ses questions peuvent interroger d’autres
formes de violence et d’aliénation, avec comme issue le mouvement et non la gesticulation, la
pensée et non la rumination. Dans notre France pacifiée, de plus en plus clôturée dans une
forteresse européenne, la violence que l’on voudrait lointaine sur nos écrans de télévision, est
bien présente : pas seulement dans les métropoles des grandes villes, mais aussi à nos portes
avec ceux que l’on ne veut plus protéger, les demandeurs d’asile qui viendront gonfler les
rangs des sans noms, des sans droits, des sans papiers. Cette violence s’adresse donc encore
aux figures de l’étranger. Et c’est avec la pensée fanonienne que l’on peut repérer la violence
psychique qui est faite à ceux que l’on prive de repères historiques, de reconnaissance, de
protection..
L’héritage de la violence coloniale est bien là, mais aussi d’autres formes de violence qui
naissent de la relation dominant/dominé, oppresseur/opprimé. Et la pensée de Fanon comme
éveilleur et comme éclaireur est plus que jamais nécessaire.
* Médecin et anthropologue, Présidente de l’association Mana,
1 Pour le « 3ème an interculturel » organisé par DiversCités, www.diverscites.org.
2 Republié dans Pour la révolution africaine. Ecrits politiques. Paris : La Découverte ; 2001 .
Source:
Mestre C. Les détours de Frantz Fanon. Bobigny : Association Internationale
d'EthnoPsychanalyse; 2006. http://www.cliniquetransculturelle.org/AIEPtextesenligne_mestre_fanon.htm
|