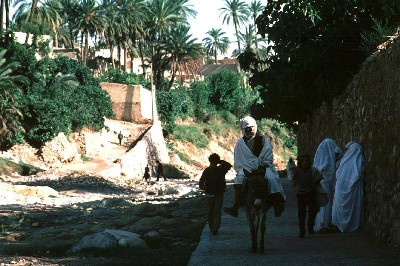Le palmier
in "Cultures Oasiennes", Youcef Nacib
En
terre d’Islam, le palmier est un arbre familier. Il n’est pas inconnu
ailleurs, certes, quand les conditions écologiques et climatiques
permette sa culture puisqu’on le retrouve même en Californie. (...) Cet
arbre joue le rôle de témoin et de compagnon culturel. Il est un facteur
de la vie familiale et communautaire. Il y jouit d’une considération
singulière pour ne pas dire d’une affection quasi parentale. Qui dit
palmeraie, dit eau ; dans les zones arides, qui dit palmier, dit vie.
Le Coran ne contient-il pas l’enseignement dont s’imprègne tout
croyant ? En effet, on y lit : « Par cette eau, Il
fait pousser pour vous les céréales, l’olivier, le palmier, la vigne
et toutes sortes de fruits. En vérité, cela est certes un signe pour un
peuple qui réfléchit » (s. XVI,11). (...) L’élection religieuse
du palmier parmi tout le règne végétal s’exprime dans les techniques
agraires traditionnelles oasiennes par mille soins entourant l’arbre
noble de sa naissance à sa mort.  L’agriculteur
de Bou-Saada peut dresser la typologie des caractéristiques de chaque
palmier de sa plantation : origine, croissance, rendement, maladies,
traitement, variété, etc. Noyau enfoui ou drageon transplanté, le
palmier ou son embryon fait l’objet d’attentions minutieuses. A la
limite, on le traite comme une personne dont on ménagerait la sensibilité.
Parmi ses palmiers, un paysan me dit un jour : « Je leur
parle ! ». L’irrigation des dattiers se fait avec amour,
doigté. Sagett ne dit-il pas que « celui-là doit se garder de
planter le palmier qui a une mauvaise haleine et qui est d’un caractère
triste » ? Il poursuit pour préciser : « Toutes
les fois qu’un homme effectue cette plantation, il doit être gai et
joyeux » (*) Cette disposition psychologique dans laquelle doit se
trouver le phoenéciculteur rappelle la purification exigée du croyant
quand il est en présence du sacral. Il
n’est pas surprenant dès lors que la conscience collective oasienne
associe le palmier au saint et que celui-ci pour elle soit le promoteur de
celui-là.(...) A Bou-Saada, dans cette perspective, seul un homme de la
trempe mystique de Sidi-Slimane pouvait entreprendre de planter le
souverain des arbres. La rencontre féconde du saint homme et du saint
arbre n’est pas singulière : nombreux sont les chroniqueurs
musulmans qui ont relevé et la fréquence et l’harmonie de ce couple
fulgurant que forment le wali et la nakhla.
L’agriculteur
de Bou-Saada peut dresser la typologie des caractéristiques de chaque
palmier de sa plantation : origine, croissance, rendement, maladies,
traitement, variété, etc. Noyau enfoui ou drageon transplanté, le
palmier ou son embryon fait l’objet d’attentions minutieuses. A la
limite, on le traite comme une personne dont on ménagerait la sensibilité.
Parmi ses palmiers, un paysan me dit un jour : « Je leur
parle ! ». L’irrigation des dattiers se fait avec amour,
doigté. Sagett ne dit-il pas que « celui-là doit se garder de
planter le palmier qui a une mauvaise haleine et qui est d’un caractère
triste » ? Il poursuit pour préciser : « Toutes
les fois qu’un homme effectue cette plantation, il doit être gai et
joyeux » (*) Cette disposition psychologique dans laquelle doit se
trouver le phoenéciculteur rappelle la purification exigée du croyant
quand il est en présence du sacral. Il
n’est pas surprenant dès lors que la conscience collective oasienne
associe le palmier au saint et que celui-ci pour elle soit le promoteur de
celui-là.(...) A Bou-Saada, dans cette perspective, seul un homme de la
trempe mystique de Sidi-Slimane pouvait entreprendre de planter le
souverain des arbres. La rencontre féconde du saint homme et du saint
arbre n’est pas singulière : nombreux sont les chroniqueurs
musulmans qui ont relevé et la fréquence et l’harmonie de ce couple
fulgurant que forment le wali et la nakhla.